Les usines du dunkerquois émettent autant de gaz à effet de serre que 1 700 000 français.

La seule usine d’ArcelorMittal émet 13,7 millions de tonnes d’eCO₂. C’est la deuxième usine la plus polluante de France.
Les institutions prévoient de doubler la capacité d’accueil du port maritime, sur fond de créations d’usines.
À Dunkerque, le climat sacrifié sur l’autel de l’industrie ?
Autour de Dunkerque, plusieurs sites industriels ultra-polluants promettent la décarbonation. S’il n’en faut pas plus pour convaincre les pouvoirs publics de multiplier les installations d’usines, l’impact climatique du territoire demeure, pour l’instant, estomaquant.
Streamez l’épisode sur toutes les plateformes…
… ou directement sur notre site !
Elle est loin, la carte postale. À moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de la plage de Malo-les-Bains, le Grand port maritime de Dunkerque se dresse, fumant, face à la mer. Les usines tournent à plein régime, comme celles d’ArcelorMittal et ses torchages, ou d’Imerys, surplombée d’un nuage de poussière. Tout indique une activité économique fleurissante, dans le vivier d’emplois que représente le grand port maritime de Dunkerque (GPMD).
Et pour cause : le GPMD n’a pas grand chose à envier aux principales zones industrialo-portuaires de l’hexagone. Troisième port français, cette institution publique a vu passer en 2020 plus de 45 millions de tonnes de marchandises et de matières premières – essentiellement du pétrole, du gaz liquéfié, du charbon et du fer. Près de 600 000 navires de fret ont pris part à la machinerie sur cette seule année, selon l’organisation européenne des ports maritimes.
Un écosystème ultra-émetteur de gaz à effet de serre
Le port de Dunkerque est donc perçu comme une richesse économique par les acteurs locaux, élus les premiers. Créateur d’emplois (près de 6 000), le GPMD a surtout permis de développer un écosystème industriel ultra-performant au fil des années. De nombreuses usines s’implémentent autour et sur le port, ravies de bénéficier d’une proximité géographique avec la façade maritime d’Europe du Nord, la northern range, dominée par le port de Rotterdam.
Paulo-Serge Lopes fait partie des rares personnes critiques, dans le bassin dunkerquois, vis-à-vis de cette industrie. Ancien militant chez Europe Écologie-les-Verts, président de l’association Virage Énergie, il milite au quotidien pour ralentir la cadence. Et reste sceptique face aux promesses de décarbonation à grands coups d’hydrogène. « Il y a un sentiment de greenwashing sur le territoire. Les industries affirment que leurs process sont propres, sans s’interroger sur les besoins réels auxquels elles répondent. Si la tonne d’acier produite sert à construire des SUV de deux tonnes qui ne seront pas utilisés pendant des années, quel intérêt ? »

Il faut bien dire que le revers de la médaille est peu reluisant. Il est même noir de suie, alors que les industries implantées sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) représentaient, en 2020, 21 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine industrielle de la France. En d’autres termes : en réunissant toutes les usines de France, on constate qu’une tonne d’eCO₂ (de gaz à effet de serre donc) sur quatre est émise par une usine du territoire de Dunkerque. Une responsabilité climatique considérable, alors que la CUD n’héberge que 200 000 habitants.
Des promesses vertes sur fond de développement industriel intensif
Force est de constater que la sphère politique ne porte pas ces lacunes environnementales en étendard. L’équipe municipale (centriste) de Dunkerque et de la CUD assume toutefois la situation. Et l’édulcore derrière les promesses de décarbonation et la nécessité de « réindustrialiser », première priorité selon Jean-François Montagne, vice-président de la communauté urbaine en charge de l’écologie. Pour cause, un taux de chômage particulièrement élevé à Dunkerque, qui comptabilisait 15 % de chômeurs en 2019.

De là à en oublier l’enjeu environnemental ? L’élu s’en défend. « De toutes façons on n’a pas le choix, on est obligés de décarboner. Après on pourra toujours dire qu’on ne fait pas assez… » Dans les faits, aucune donnée publique ne semble établir que les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie dunkerquoise sont en diminution. Et rien, pour le moment, ne rend plausible le scénario marketing promu par les industries et par l’État, celui « d’un port neutre en carbone horizon 2050 ». À Jean-François Montagne de rappeler, tout de même, que « la qualité de l’air s’améliore ».
Il n’en faut pas beaucoup plus pour motiver les pouvoirs publics, à tous les niveaux, à se lancer dans une politique intensive de développement industriel. Le 12 mai dernier, l’entreprise de batteries pour voitures électriques ProLogium annonçait la création d’une gigafactory, anglicisme emprunté au milliardaire américain Elon Musk pour désigner des usines de batteries aux proportions gigantesques. Plusieurs dizaines d’hectares de terres agricoles sont en jeu. Quelques mois plus tôt, l’entreprise français Verkor décidait, précurseuse, d’implanter elle aussi une gigafactory dans le dunkerquois.
D’importants manquements réglementaires pointés du doigts
Le fond de l’affaire pourrait néanmoins ne pas résider dans ces politiques d’implantation d’usines, mais plutôt dans l’écosystème dans lequel elles s’intègrent. En cause : le développement des infrastructures portuaires, porté par le projet Cap2020 du GPMD. Ce dernier prévoit de faire passer sa part de marché du fret maritime mondial de 0,7 % à 2,3 % d’ici 12 ans. Un projet titanesque, qui passe par un dédoublement de la capacité d’accueil du port, et des travaux d’aménagement considérables, implicant plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d’excavation.

L’Autorité environnementale s’est d’ailleurs fendue d’un délibéré au vitriol, le 11 mai 2023, dénonçant le manque de considérations écologiques dans le développement du projet Cap2020. La quinzaine d’experts désignée pour étudier le projet dénonce ainsi « une étude d’impact de qualité médiocre », des « impasses sur des enjeux environnementaux essentiels » tels que l’artificialisation ou les mesures compensatoires. L’étude d’impact, chargée d’apprécier les enjeux écologiques avant la mise en oeuvre du chantier, présenterait « des lacunes graves tant sur le fond que sur la forme ». De quoi nuancer les discours environnementalistes des promoteurs de l’industrie dunkerquoise.
« Une chorale très particulière »
Autant dire que l’ambiance entre les quelques militants écolos et la collectivité territoriale n’est pas toujours chaleureuse. Pour Paulo-Serge Lopes, la multiplication de synergies entre les collectivités territoriales, les organismes de recherche, certains services de l’État et l’industrie a amené à une uniformisation du discours, et « à une absence de critique assez étonnante ». Tout comme l’Autorité environnementale, Paulo-Serge Lopes fait valoir le manque de transparence dans les processus de concertation citoyenne. Un point que Jean-François Montagne balaye du revers de la main. « Regardez le nombre de consultations et de débats publics que l’on mène autour des implantations d’entreprises ! On pourra toujours dire que les citoyens ne s’emparent pas du débat, mais c’est autre chose. »
Certaines tensions entre la collectivité territoriale et des associations de défense de l’environnement posent toutefois question. L’Association de défense du littoral Flandres Artois (ADELFA) s’est ainsi vue retirer ses subventions et expulsée des locaux qu’elle occupait, suite à un désaccord avec la CUD sur un autre dossier. Une décision politique ? Si le maire de Dunkerque évoque auprès de la Voix du Nord des « divergences profondes » avec la maison de l’environnement, rien ne permet d’affirmer que le retrait des subventions du principal collectif environnementaliste du dunkerquois soit directement lié à ses activités. Interrogé sur ce point, Jean-François Montagne a toutefois mis fin à notre entretien.
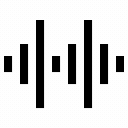 Chargement en cours...
Chargement en cours...




